Activités > Voyages
Publié le 25 juin 2025
A METZ et dans les Pays lorrains “Si paix dedans, paix dehors” Septembre 2024
- ven 27 septembre 2024
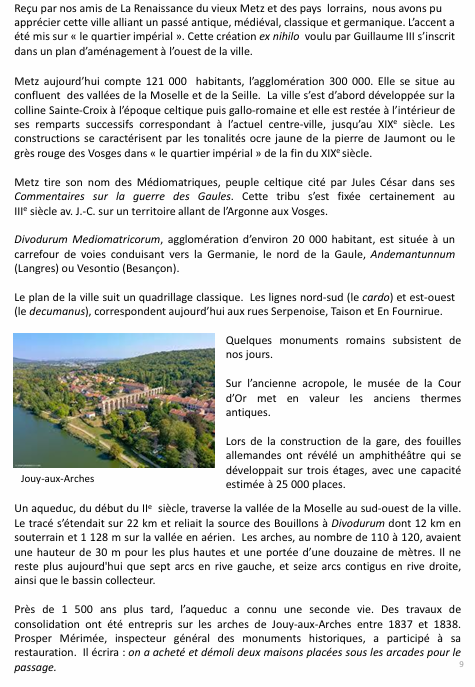
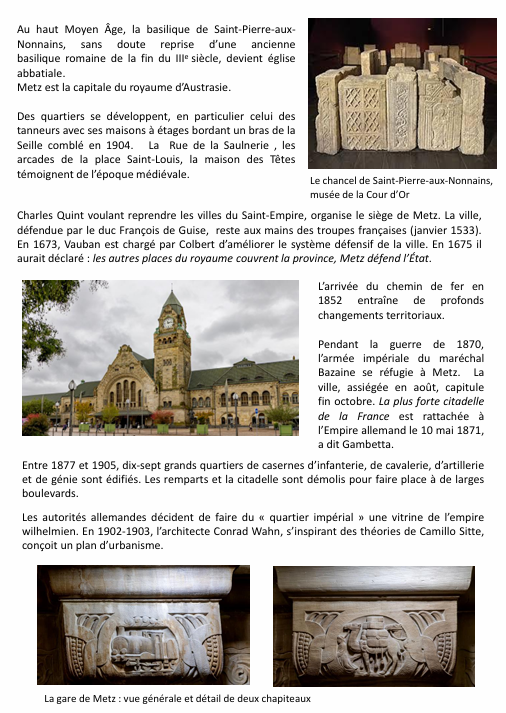
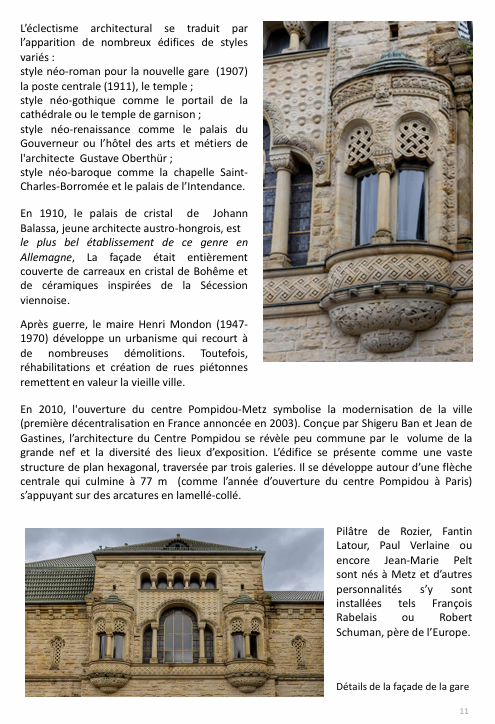
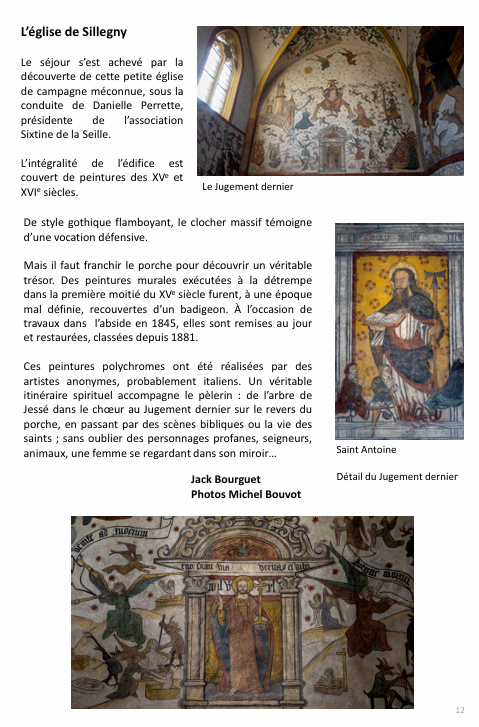
Deux contributions de nos amis de la Renaissance du vieux Metz et des pays lorrains à lire dans l’onglet contributions: « Une brève histoire des juifs de Metz » et « Le particularisme alsacien-mosellan ».
